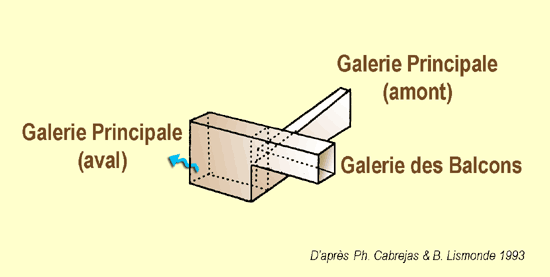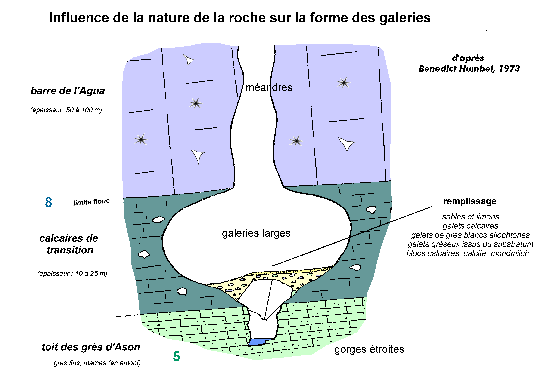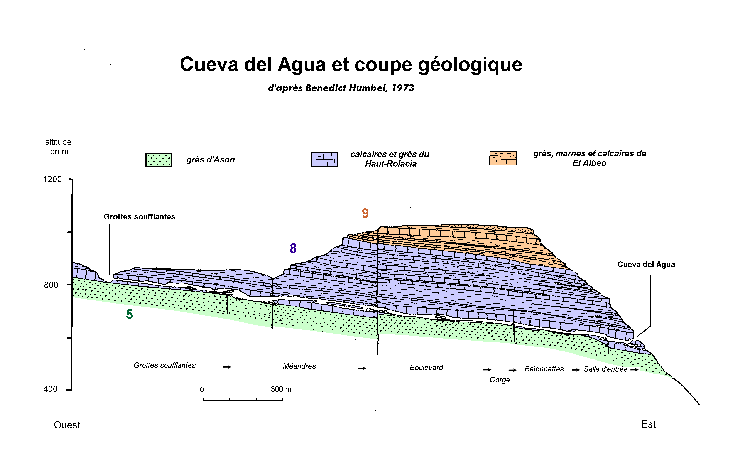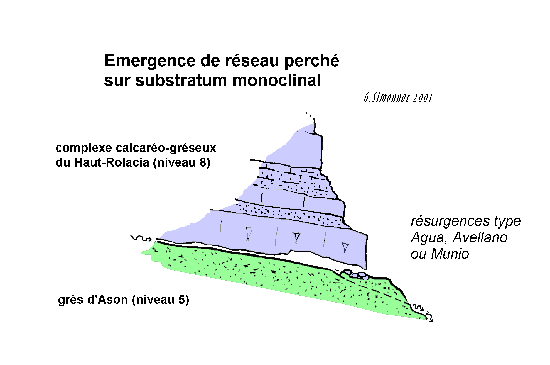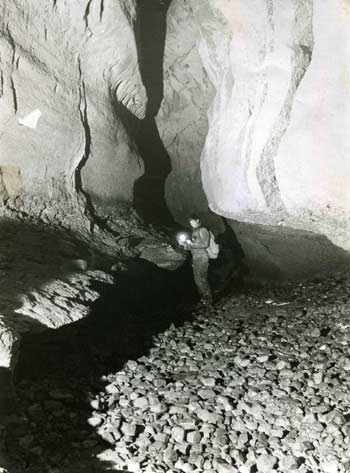Le réseau de la cueva del
Agua (n°32)
Développement : 10 033 m
Dénivellation : 225 m
La cueva del Agua revêt un statut particulier
dans le secteur. En effet, bien que n’ayant pas l’ampleur des
grandes cavités qui font la réputation du massif (Fresca, Cayuela,
Coventosa, Gandara etc…) elle figure parmi les classiques les plus visitées.
Véritable « grotte-tunnel » qui double une partie du ravin
de Rolacia, elle offre un parcours agréable, facile et très
diversifié tant par son approche dans les vallons sauvages de Rolacia
que par la variété des paysages souterrains. Sur le plan purement
spéléologique, l’essentiel de l’exploration semble
avoir été fait, mais la simplicité de la topographie
actuelle ne doit pas masquer la complexité de la genèse du réseau
souterrain qu’il faudra relier au creusement du vallon de Rolacia et
aux nombreuses cavités qu’on y rencontre.
Situation et accès
Description de la cavité
Contexte géologique et hydrologique
Historique des explorations
Liens divers (galerie, topos...)
Situation et accès
La cueva del Agua se développe dans la partie nord du
massif de la Colina, parallèlement au flanc sud du ravin de Rolacia.
Elle possède 2 groupes d’entrées situées aux deux
extrémités du réseau :
- Cueva del Agua (entrée fossile et résurgence pérenne,
n°32)
x = 450,437 ; y = 4786,569 ; z = 615 m
- Grottes Soufflantes (n°54)
x = 448,398 ; y = 4786,583 ; z = 820 m
Commune de Soba
Pour atteindre l’entrée des grottes soufflantes,
il faut prendre le chemin muletier qui remonte le ravin de Rolacia dans sa
partie boisée. Au niveau de sa confluence avec le rio Munio (affluent
rive gauche), et avant que le sentier ne commence à serpenter sur les
pentes raides du flanc nord , il faut rejoindre à gauche une belle
prairie occupée par les cabanes de Rolacia. Dans l’axe de la
vallée et en regardant l’amont on devine la rupture de pente
correspondant aux cascades de Cuesta Avellano. Les grottes soufflantes se
situent juste en amont, mais pour les atteindre le plus dur reste à
faire.
Deux options sont envisageables mais dans les deux cas un bon sens de l itinéraire
s’impose sans oublier de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire
permettant d’affronter la végétation luxuriante et les
insectes en tous genres (moustiques et taons) qui ont fait la réputation
de la vallée.
La première solution consiste à monter les pentes raides et
herbeuses qui dominent, sur la gauche, les dernières cabanes. Que l’on
prenne à droite ou à gauche du petit vallon qui coupe cette
pente, on évitera cet itinéraire exposé par temps de
pluie où lorsque les hautes herbes sont encore couchées par
la neige. Parvenu au premier rang de falaises, une centaine de mètres
plus haut, il convient ensuite de longer ces dernières vers l’amont
pour rejoindre le sommet des cascades et la confluence avec le ruisseau qui
sort de la cueva de Cuesta Avellano (ne rejoindre le ruisseau qu’au
dernier moment).

Le ravin de Rolacia vu des vires qui rejoignent,
en rive droite, le sommet des cascades de Cuesta Avellano. Le sentier venant
d'Asón remonte le vallon dans la forêt en rive gauche. Il faut
le quitter à la confluence avec le rio Munio et changer de versant
pour rejoindre la prairie où l'on distingue les cabanes de Rolacia.
La seconde solution emprunte l’autre flanc de la vallée.
De l’extrémité de la prairie, il faut gagner au mieux
le bas des cascades puis grimper sur la rive gauche du ravin jusqu’au
dessus des cascades. En été, fougères et ronces sont
vigoureuses et gênent considérablement la progression, c’est
pourquoi, il est préférable de choisir cette option à
la morte saison.
Lorsqu’on parvient au sommet des cascades, on laisse sur la droite le
ruisseau provenant de la cueva de Cuesta Avellano et il suffit alors de remonter
la vallée sur une centaine de mètres en suivant de près
le cours d’eau principal jusqu’au moment où il longe un
rang de falaise caractéristique. Dans celui-ci, à 3 m du sol
s’ouvrent les 3 porches des grottes soufflantes. Au total, il faut prévoir
2 bonnes heures de marche d’approche (570 m de dénivelé).
L’accès à la cueva del Agua n’est pas non plus une
partie de plaisir et avant de se lancer dans l’ascension, il est conseillé
de bien observer la configuration du site afin de prendre quelques repères.
Aucun sentier digne de ce nom conduit au porche, toutefois, le passage répété
des spéléos effectuant la traversée a marqué une
vague trace qui sert de fil conducteur. Globalement, celle-ci emprunte la
croupe dégarnie et bien marquée située au nord (à
droite) du vallon issu de la grotte. Pour l’atteindre, il faut déjà
franchir le rio Asón au niveau de l’église du vieil Asón
puis remonter le sentier qui donne accès aux prairies qui occupent
le bas de la croupe citée précédemment. Peu à
peu le sentier se dilue dans la lande et il faut veiller à toujours
suivre au plus près la ligne de crête. Lorsque l’on parvient
sur le dernier gradin pentu avant la falaise où s’ouvre la cueva,
il suffit de couper en biais sur la gauche et au milieu des ronces et des
fougères pour rejoindre le porche d’entrée. Il faut compter
une bonne heure de marche depuis le fond de la vallée (370 m de dénivelé).

La cueva del Agua et la vallée de Rolacia
au second plan. On distingue très nettement le niveau gréseux,
plus sombre, juste sous la 1° barre calcaire (dite barre de l'Agua).
Au fond, la pyramide sommitale de Porracolina domine le hameau de Sotombo
en amont du vallon où s'ouvre la cueva del Rio Munio, un affluent de
Rolacia.
(les commentaires et l'itinéraire d'accès apparaissent en passant
la souris sur l'image)
Haut de page
Description de la cavité
La cueva del Agua est une cavité à développement
essentiellement horizontal, établie au toit du complexe gréseux
d’Asón affecté ici d’un pendage régulier
de l’ordre de 8 à 10° en moyenne. Globalement, l’organisation
des galeries est assez simple ; la grotte est constituée d’un
conduit principal, long de 2 600 m reliant les grottes Soufflantes à
la cueva del Agua, unique résurgence du réseau. Quelques affluents
et des conduits fossiles supérieurs viennent se greffer sur celle-ci.
La galerie principale
Elle est parcourue d’ouest en est par un ruisseau souterrain
que l’on suit pratiquement tout au long de la traversée. Pour
faciliter la description, nous la traiterons d’amont en aval en la subdivisant
en 6 tronçons correspondant à des morphologies distinctes.
Les grottes Soufflantes
Cette première partie, jusqu’à la trémie
de la jonction, forme une sorte de delta inversé dont les différentes
branches devaient correspondre à des captures du ruisseau de la Sota.
Actuellement trois porches, perchés 3 mètres au-dessus du ruisseau,
permettent d’accéder à la partie amont du réseau
qui se développe sur les calcaires de transition facilement reconnaissables.
L’orifice médian est sans aucun doute le plus accessible (ressaut
de 3 m, corde en place). Les galeries qui leur font suite se rejoignent très
rapidement pour former un joli conduit de 2 à 10 m de large pour 8
à 12 m de haut. Au niveau de la confluence des 3 grottes, un méandre
parcouru par un courant d’air très net a été remonté
jusqu’à des trémies sans doute proches de la surface.

L'entrée médiane des Grottes Soufflantes.
On l'atteint par une escalade de 4 m le long des calcaires de transition.
La galerie, sinueuse au début, devient brusquement rectiligne lorsqu’elle
rencontre une faille NW-SE. Elle prend alors la forme d’une diaclase
assez haute, du moins lorsque le conduit se développe dans la première
barre calcaire (ou barre de l’Agua, Humbel 1969). Dans les calcaires
de transition, il a tendance à être plus large tandis que les
parois deviennent plus ébouleuses. Par endroit, une galerie supérieure
double le conduit principal qui prend peu à peu de l’ampleur.
La progression est facile et seul un ressaut de 5 m formé par un amoncellement
de blocs ralentit la progression. Une cinquantaine de mètres après
ce dernier, un affluent rive droite apporte à la fois de l’eau
ainsi qu’un bon courant d’air qui vient s’ajouter à
celui déjà important qui nous accompagne depuis les grottes
soufflantes.

Par endroit, le méandre se dédouble
et, en hauteur, le chenal de voûte peut avoir creusé un conduit
localement indépendant.
De là, il faut encore avancer de 50 m pour arriver à
la trémie de la jonction. Cette dernière est assez courte et
le fléchage abondant permet de trouver facilement le bon passage. En
se glissant entre les blocs (R.6) on retrouve rapidement le cours d’eau
qui a creusé ici de profondes marmites. Historiquement, nous quittons
les grottes soufflantes pour entrer dans la cueva del Agua dont la trémie
est demeurée l’extrémité amont jusqu’en 1973.
Les méandres
Juste après la trémie, le ruisseau entaille le
niveau supérieur du complexe gréseux d’Asón (marnes
et grès) formant de belles et profondes marmites rendues glissantes
par la patine particulière de la roche. Heureusement, un équipement
en place facilite leur franchissement. A la fin de la série de marmites,
le ruisseau disparaît en rive gauche dans un conduit bas et ventilé
: la rivière des Marmites (voir descriptif plus loin). Celle-ci se
perd 200 m plus loin dans une voûte mouillante et ne réapparaît
dans la galerie principale que bien plus loin en aval, au niveau de l’affluent
du Loir.

Les Marmites, juste après la trémie
de la Jonction, sont creusées dans les grès d'Asón.
A partir de cette diffluence, et à la faveur d’un abaissement
local de la série, « les méandres » se développent
désormais dans les calcaires. Ils constituent un ensemble désordonné
de galeries souvent sinueuses. La morphologie type est celle de conduits larges
de 2 à 4 mètres à la base, hauts d’une quinzaine
de mètres, avec des parois très irrégulières :
tantôt symétriques en forme de « trou de serrure »,
tantôt très dissymétriques notamment dans la partie aval
des Méandres. La roche, très compacte et très claire
est façonnée de milliers de petites cupules. Le sol est recouvert
par un remplissage épais. Dans les parties basses, parcourues par le
ruisseau en temps de pluie, il s’agit principalement de galets calcaires
et gréseux. Dans les parties surélevées, aujourd’hui
abandonnées par les eaux, le remplissage est beaucoup plus sablonneux.
Une part non négligeable des galets est constituée par des grès
blancs très durs, dont on ne connaît aucun affleurement dans
la grotte. Ceux-ci ont donc été apportés soit de l’extérieur,
soit de conduits karstiques situés plus haut dans le massif qui recouperaient
l’un des bancs de grès que l’on connaît dans la série.

Une section caractéristique du secteur
des Méandres. Le ruisseau s'écoule dans un conduit parallèle
plus récent et la Galerie Principale n'est active qu'en période
de très hautes eaux. Le sol est couvert de galets essentiellement grèseux
et les parois sculptés sont creusées dans les calcaires massifs
de la barre de l'Agua.
Environ 200 m après les marmites, le méandre se divise. A gauche
en hauteur, et en grimpant de quelques mètres on atteint un conduit
plus petit (« Le Shunt »), entrecoupé de passages bas.
Cent trente mètres plus loin, celui-ci débouche latéralement
dans une galerie plus ample au fond de laquelle s’écoule la rivière
perdue au niveau des Marmites. La progression en amont se heurte rapidement
à une voûte mouillante, mais juste avant, on croise le débouché
de l’affluent du Loir. En aval, une quarante de mètres plus loin,
on retrouve l’autre branche du méandre qui, bien que plus ample,
offre un parcours accidenté et peu commode. A partir de là,
la galerie principale devient encore plus sinueuse et présente localement
quelques diffluences.

La rivière retrouvée à
la sortie du Shunt que l'on aperçoit à gauche devant le personnage.
Le Boulevard
La morphologie change assez brutalement et l’on passe
des Méandres au Boulevard au niveau d’un virage bien marqué
de la galerie. Les proportions prennent aussitôt de l’ampleur
(5 à 15 m de large pour 10 à 15 m de haut) car le conduit s’enfonce
dans les calcaires de transition, sous la barre calcaire compacte qui constitue
la voûte. Le sol est formé sur une centaine de mètres
par les grès du toit du complexe gréseux d’Asón.
Partout ailleurs, il est recouvert par une épaisseur plus ou moins
grande de blocs, de graviers calcaires et de galets calcaires et gréseux.
Le Boulevard est quasiment rectiligne sur toute sa longueur empruntant une
fracture est-ouest légèrement oblique par rapport au pendage
(est sud-est).

Lorsqu'il s'enfonce dans les calcaires de transition,
le conduit Principal prend de l'ampleur.
La Gorge
Au sortir du Boulevard, la galerie se rétrécit
en une diaclase large de 2 à 3 mètres seulement, en même
temps qu’apparaissent dans le lit du ruisseau les grès à
patine rousse du toit du complexe gréseux d’Asón. Cette
portion de galerie, longue de 80 m et rigoureusement rectiligne est une des
plus pittoresques de la grotte. On y voit le ruisseau souterrain, par cascades
successives, s’enfoncer de marmites en marmites jusqu’à
plus de 5 m sous le toit des grès d’Asón, et passer finalement
sous un pont de grès reliant les deux parois de la galerie.

Au niveau de la Gorge, le ruisseau souterrain
s'enfonce brutalement dans les grès par une série de petites
cascades très esthétiques.
Le reste de la diaclase, dont la hauteur dépasse 15 m s’élève
dans les calcaires de transition (très peu épais ici) et la
première barre des calcaires construits. Vers l’aval, la Gorge
se termine par un chaos de blocs au niveau duquel une faille interrompt momentanément
l’affleurement des grès.
Les Baïonnettes
Elles sont établies sur un système bidirectionnel
de fractures et sont formées par de courtes lignes droites séparées
par des virages à angle droit. La largeur moyenne des galeries est
de 4 à 5 m et la hauteur de 1 à 12 m. Les parois et la voûte
sont creusés dans les calcaires de transition, et le sol est formé
en quatre endroits différents par les grès du complexe gréseux
d’Asón. Le fond du ruisseau est occupé par un remplissage
de sable et de galets parmi lesquels 70% environ sont constitués par
les grès blanc déjà mentionnés plus haut. Les
30 % restants se repartissent pour moitié en galets calcaires et en
galets de grès issus directement du substratum. Ces remplissages, compte
tenu de la faible pente locale, jouent le rôle de barrages et forment
des bassins imposant de s’immerger jusqu’à la taille.

Plusieurs bassins, plus ou moins profonds, jalonnent
les Baïonnettes. Dans celui-ci, le puissant courant d'air parvient à
former des vaguelettes à la surface de l'eau.
Après 250 m de ce parcours sinueux, la galerie prend progressivement
de l’ampleur en même temps qu’elle reçoit, en rive
gauche, plusieurs arrivées qui correspondent au débouché
d’une galerie fossile supérieure et sensiblement parallèle
à l’aval des Baïonnettes. Pour terminer la traversée,
il ne reste plus qu’à traverser la Salle d’Entrée.
La salle d’entrée.
Avec une longueur de 250 m et une largeur maximum de 50 m,
la Salle d’Entrée constitue l’élément le
plus imposant de la grotte. Elle est établie dans les calcaires de
transition, sa voûte étant constituée par la dalle de
base de la barre de l’Agua , et son plancher, en deux endroits différents,
par les grès du complexe gréseux d’Asón.

Par endroit, le plancher de la salle d'Entrée
laisse entrevoir les grès.
On peut distinguer deux parties dans cette salle. Dans la première,
le plancher est situé à peu près au même niveau
que dans les Baïonnettes ou dans la galerie Supérieure fossile.
C’est la partie amont de la salle. Dans celle-ci, la voûte est
assez irrégulière et il existe un grand nombre de blocs effondrés
sur le plancher. La moitié nord de la salle est occupée par
une sorte de plate-forme, qui domine de quelques mètres le lit du ruisseau.
Dans la seconde, le plancher est situé une quinzaine de mètres
plus bas. La voûte est beaucoup plus régulière et s’incline
doucement vers le sud. Le sol de la salle est constitué par un épandage
de blocs, de galets calcaires et gréseux. Il n’existe plus de
plate-forme surélevée au nord, mais une sorte de glacis à
forte pente recouvert de mondmilch.
A son extrémité, la salle d’Entrée ne communique
pas directement avec la résurgence principale. Un important chaos de
blocs, résultant d’un effondrement partiel de la voûte,
obstrue presque entièrement l’entrée. Il faut, pour sortir
de la grotte, escalader ce chaos et passer au ras de la voûte.
Les galeries secondaires
Galerie en amont des grottes Soufflantes :
Ce beau conduit s’ouvre immédiatement en rive
droite de la galerie d’entrée des grottes Soufflantes. Après
40 m de galerie confortable il se termine par deux méandres devenant
rapidement impénétrables. Juste avant, une cascade tombe de
la voûte et constitue la première alimentation du ruisseau de
l’Agua.

La galerie en amont des grottes Soufflantes
débute par un beau conduit qui, hélas, s'interrompt très
rapidement.
On distingue bien le contact entre les calcaires de transition plus ébouleux
(au bas, conduit plus large) et les calcaires massifs de la barre de l'Agua
(en haut).
Le méandre qui Souffle (secteur amont des grottes
soufflantes)(555 m)
Celui-ci s’ouvre juste en face de la galerie venant de
l’entrée médiane. Ce méandre apporte un fort courant
d’air qui, en partie, ressort en été par l’entrée
des grottes Soufflantes et explique l’appellation de ces cavités
qu’on aurait pu penser aspirantes. Le méandre (0,80 m de large)
se heurte à une petite cascade de 4 m au bout de 70 m. A son sommet
on atteint un laminoir ponctuel puis la morphologie en méandre reprend
ses droits. La largeur par endroit n’excède pas 30 cm et après
450 m de progression, le conduit butte sur deux trémies proches de
la surface. A ce niveau, le courant d’air a sensiblement perdu de sa
vigueur.
La galerie G-S et les conduits supérieurs des grottes
Soufflantes
La galerie G-S s’ouvre à environ 150 m de l’entrée
des grottes Soufflantes, en rive gauche. C’est un conduit remontant
qui se dédouble avant d’arriver à une salle formant un
virage à 180°. Elle se termine sur 2 branches une cinquantaine
de mètres plus loin (dév. : 190 m).
Juste au-dessus de ce départ, dans la galerie principale des grottes
Soufflantes, il est possible de suivre le méandre de voûte sur
une cinquantaine de mètres de longueur. De même, au niveau du
R.5, il est possible d’accéder à un niveau fossile non
topographié Ce dernier a été visité sur une quarantaine
de mètres.
La rivière des Marmites et la galerie du Léthé
Dans la galerie Principale, juste après la trémie
de la jonction et les marmites, le ruisseau se perd en amont d’un éboulis.
Peu avant, une galerie basse parcourue par un violent courant d’air
soufflant permet d’accéder au bout de quelques mètres
à la rivière des Marmites.
En aval, celle-ci récupère la perte citée précédemment.
Le ruisseau, grossi de cet apport substantiel, s’écoule dans
un conduit bas creusé en partie dans le toit des grès d’Asón.
Il disparaît 200 m plus loin dans une voûte mouillante et réapparaît
probablement dans la galerie Principale, après le Shunt, au niveau
du débouché de l’affluent du Loir. Soixante mètres
avant ce passage noyé, un affluent en rive gauche a été
reconnu sur 50 m (à suivre).
L’amont n’ayant pas encore bénéficié de la
diffluence du ruisseau provenant des Marmites, est plus étroit et souvent
assez bas notamment au passage de plusieurs blocs effondrés. Au bout
de 300 m, il recoupe une galerie plus ample creusée dans les calcaires
: la galerie du Léthé (largeur et hauteur moyenne de 5 à
6 m). Celle-ci se développe parallèlement à la galerie
Principale. En amont, elle a été remontée jusqu’à
un dédoublement du conduit terminé dans les deux cas par des
trémies. En aval, la galerie devient chaotique et se heurte au bout
de 150 m à une trémie toute proche de celle de la jonction.
Un très net courant d’air la parcourt et il semble évident
que cette galerie communiquait autrefois avec le conduit principal.
Réseau du Loir et rivière 64
Dans l’aval des méandres, le Shunt rejoint un
ruisseau issu de toute évidence de la rivière des Marmites via
une zone noyée. Il a été remonté sur une quarantaine
de mètres jusqu’à une voûte mouillante située
en vis-à-vis de celle qui termine l’aval des Marmites à
une centaine de mètres de distance. Mais juste avant que la voûte
plonge, en rive gauche, s’ouvre le départ (R.4) d’une diaclase
étroite dans laquelle un squelette de Loir a été découvert
en 1969. Après cette diaclase, il faut franchir deux chatières
pour accéder à un réseau de boyaux surbaissés,
au plancher pétrifié par la calcite ou recouvert de galets.
Quelques diverticules n’ont pas été topographiés
mais ils demeurent d’un intérêt très limité.
Les réseaux supérieurs et intermédiaires
du SGCAF
Philippe Cabréjas et Baudoin Lismonde (S.G.C.A.F.) ont
publié une description détaillée des conduits qu’ils
ont découvertes au-dessus de la Galerie Principale. Nous la reproduisons
ici quasiment intégralement :
« II s'agit principalement d'anciens cours de l'Agua situés entre
30 et 60 m au dessus du cours actuel. Coté aval, nous sommes retombés
dans le Grand Canyon non loin du Grand Boulevard. Coté amont, les galeries
communiquent avec les réseaux supérieurs de l'actif actuel au
niveau de la galerie du Léthé et collectent, par quelques arrivées,
l'eau du plateau au dessus.
Alors que le style général du réseau est celui d'une
grande cavité creusée en écoulement libre, les nouvelles
parties découvertes sont mixtes. La partie la plus haute est formée
de galeries en écoulement noyé partiellement surcreusées
par des écoulements libres. Plus bas les écoulements libres
ou noyés-dénoyés dominent. À noter la présence
d'un important remplissage de sable et de galets de grès (jusqu'à
30 cm), typiques de ce coin de Cantabrie.
Un simple coup d'oeil sur la coupe projetée des nouveaux réseaux
montre l'existence de deux niveaux de galeries. Le niveau intermédiaire,
est situé en moyenne 30 mètres au dessus de l'actif et le réseau
supérieur 50-60 mètres plus haut que l'actif.
Le réseau intermédiaire (par Philippe Cabrejas)
Actuellement l'accès à ce réseau peut
se faire de trois façons :
- l'escalade du SGCAF réalisée au printemps 1993
- une escalade dans le puits-diaclase qui sort au nord de la salle de la Cascade
- Une autre escalade plus en amont que la précédente dans le
méandre. C'est par ce chemin qu'un espagnol a fait quelques mètres
de première et après avoir écrit quelques mots sur le
sol est reparti, laissant devant lui des galeries géantes vierges.
Vu la topo, le réseau est complexe. Toutefois on peut déjà
différencier les galeries où la progression est simple et les
autres réseaux où le spéléo de taille normale
est plus souvent à quatre pattes plutôt que debout.
Commençons la visite guidée par les réseaux faciles.
C'est d'ailleurs naturellement par celles-ci que nous avons été
attirés d'entrée de jeu. En arrivant de l'escalade du SGCAF,
on peut finalement aller soit à la salle du Menhir, soit au puits remontant
de la Douche. Vers le Menhir, on parcourt une galerie en conduite forcée
dont le plancher est recouvert de sable propre. La progression est très
agréable. Dans cette galerie, au mois de mai, on a trouvé des
traces sur 50 m. Cette galerie est en position supérieure et de celle-ci
part une multitude de galeries aux dimensions plus réduites, toujours
avec un sol sableux qui s'interconnectent en aval. En se dirigeant vers la
salle du Menhir, les dimensions se réduisent, et il faut franchir une
trémie scabreuse. En effet cette salle est située dans un secteur
faillé.
Le même phénomène se reproduit à l’approche
de la salle de la Douche, où après une galerie de bonne dimension,
nous voici confrontés à quelques étroitures, puis à
une diaclase pour enfin découvrir la dite salle. Lors de la première,
nous avons retrouvé Baudouin et Sylvain qui faisaient de la topo, mais
trente mètres au-dessus. Dans la partie sympathique de cette galerie,
une bifurcation permet d'accéder au puits du Chien qui communique également
par un autre passage avec la galerie précédemment décrite.
Fini de se promener debout, passons au ramping. Trois réseaux ont été
découverts dans ce secteur. Ils sont tous en position inférieures
vis à vis des deux précédentes galeries. Deux s'atteignent
par le ressaut RIC (Ressaut Ingrid Corinne). De ce point de départ,
on se retrouve après un passage étroit et chaotique dans une
salle où trois niveaux de galeries communiquent : la partie inférieure,
où coule la rivière dans un méandre ; le niveau médian
avec les galeries des Hijas et des Sapins et, au sommet, les galeries où
la progression est aisée.
Restons dans l'étage intermédiaire: cinquante mètres
plus loin, il faut choisir entre la galerie des Sapins et la galerie des Hijas.
Cette dernière se termine après un développement important
sur un rétrécissement dû à un colmatage de la galerie.
Il y a sûrement de la première à faire...
La galerie des Sapins, dont le nom vient de quelques concrétions ayant
cette forme, permet de rejoindre le puits de la Douche. Ce réseau est
caractérisé par une conduite forcée d’un mètre
de diamètre, très propre qui contraste avec le reste du secteur
où la boue est reine. Cette conduite est largement arrosée quand
les précipitations sont importantes en surface.
La troisième galerie de dimension modeste rend compte de l'aspect labyrinthique
de cette partie du réseau. Deux possibilités s'offrent au spéléo
pour visiter ce secteur. Les directions de cette galerie sont sujettes aux
diaclases, aux fractures, on tourne quasiment en rond. Nous nous sommes arrêtés
sur manque de moral, mais la galerie continuait et devait sûrement ressortir
en un lieu connu puisque nous entendions Sylvain et Baudouin qui progressaient
non loin.

Les Méandres, un profil typique du réseau.
Le réseau supérieur (par Baudouin Lismonde)
II est parallèle à l'actif actuel et se trouve
environ 35 mètres au dessus de lui. Il est de plus en plus gros de
l'amont vers l'aval. Il débute à l'Ouest par la galerie de Mai
qui était alimentée par en dessous (deux puits). Ensuite cette
galerie se ramifie en plusieurs boyaux-laminoirs dont l'un est connecté
à la salle du Menhir, importante salle d'effondrement et l'autre au
puits de la Douche. Ces boyaux continuent vers le carrefour du Chien, étonnant
carrefour dont on ne trouve que difficilement les 6 départs. On s'échappe
vers l'Est par deux galeries, la galerie de Porcelaine et le laminoir des
Racines. Ce dernier, dont le parcours est très douloureux pour les
genoux, est rendu remarquable par deux curiosités : la première
est constituée par des concrétions excentriques de 1 à
3 cm de diamètre qui peuvent atteindre 50 cm de longueur. Bien qu'elles
soient opaques, certaines sont élégantes (la «main»).
La deuxième curiosité est la présence d'un squelette
de mammifère non encore identifié. On se demande vraiment comment
la bête a pu arriver là !
La galerie de Porcelaine est concrétionnée elle-aussi et facile
de parcours. Après le carrefour 2, la galerie Ouest est plus grande
de 2 à 5 m de hauteur et autant de largeur. La roche est noirâtre
et délitée, et le sol est recouvert de gravats. Elle nous conduit
très facilement au Carrefour de la Joie (celle des explorateurs du
mois de Mai). C'est en effet par là qu'on débouche dans ce réseau
supérieur. La galerie continue en changeant de morphologie. La galerie
Est a l'allure d'une conduite forcée classique de 4 mètres de
diamètre légèrement surcreusée par des marmites
sèches. Au dessous de cette galerie se développe le réseau
des Boucles constitué d'un labyrinthe de galeries communiquant avec
le Grand Canyon sous-jacent. Les galeries du Sud de ce petit réseau
sont ébouleuses alors que celle du Nord sont sableuses, différence
qui correspond sans doute à une variation de faciès de la roche.
Continuons à progresser dans la galerie Est. Elle s'évase et
débouche par un grand Balcon à 30 mètres de hauteur dans
le Grand Canyon. On peut, en longeant à gauche une vire sableuse, rejoindre
la galerie des Balcons qui est la plus grande de toutes celles décrites
ici. C'est une conduite forcée de 8 mètres de diamètre
au sol de sable et de gros galets. Elle file vers le Nord et à mi-parcours,
elle est surcreusée par un méandre qui atteint 6 mètres
de profondeur et dans lequel on est obligé de descendre. Cette galerie
se jette dans la Galerie Principale à40 mètres de hauteur et
le site est remarquable car le plancher de notre méandre correspond
au plafond du Canyon vers l'amont alors que la plafond de la galerie des Balcons
correspond au plafond de la galerie aval.
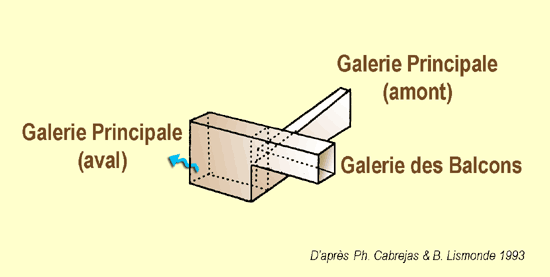
La hauteur des Méandres à l’aval telle qu'on peut la voir
à partir de la galerie du Grimpeur (balcon 4) dépasse 60 m.
alors qu’en amont elle est de l'ordre de 35 m.
La galerie originelle a divagué latéralement, plus ou moins
en écoulement noyé, puis le niveau général de
l'eau ayant baissé, l'eau s'est échappé dans la galerie
Principale.
La particularité de la galerie Principale est qu'elle est creusée
dans un splendide calcaire blanc avec de vastes banquettes - horizontales
de 2 à 8 mètres de largeur étagées sur différents
niveaux. Ces banquettes spacieuses n'ont rien à voir avec des banquettes
de méandre qui sont à contre pente et résultent de l'érosion
régressive des cascades. Elles sont dues ici au niveau que prend le
lit de galets. En effet toutes les galeries actives présentent un lit
de galets ou de sable provenant de bancs de grès intercalés
dans le calcaire. L'eau élargit la bordure du lit comme lorsqu'elle
coule sur un niveau de roche insoluble. Mais la corrosion sous remplissage
creuse un chenal de 2 mètres environ qui reste rempli de galets. À
l'occasion d'une crue ou d'une érosion régressive, le niveau
des galets descend et l'eau entame le creusement d'une nouvelle banquette.
La dénivellation entre deux banquettes est de l'ordre de 5 mètres.
On remarque, sans trouver d'explication simple, que les banquettes les plus
élevées sont souvent couvertes de galets (20 cm) alors que celles
plus bas sont propres ou sablonneuses.
De même, le lit de galets des galeries fossiles est souvent cimenté
par un liant assez dur, alors que les galeries actives ont des galets non
cimentés. »
Galerie Supérieure Fossile
Elle prolonge la Salle d’entrée vers l’amont
et se développe parallèlement à la galerie Principale
sur 600 m. Elle est établie dans la barre de l’Agua et les calcaires
de transition, avec des regards au travers du remplissage sur le toit du complexe
gréseux d’Asón. Son profil transversal est celui d’une
diaclase verticale s’élargissant à la base dans les calcaires
de transition. Sa largeur et sa hauteur se réduisent vers l’amont.
Le remplissage est constitué de pierraille calcaire dans la partie
aval et, dans l’amont, il passe à une double couche de mondmilch
et de glaise supportant des blocs calcaires.
Un système de petites galeries conformes au pendage des grès
relie l’aval de cette galerie avec les derniers coudes des Baïonnettes.
Haut de page
Contexte géologique et
hydrologique
Dans la description détaillée du réseau
un certain nombre d’observations géologiques sont signalées.
La morphologie des galeries y apparait très directement liée
à la nature de la roche encaissante :
- Haut méandre originel dans la barre calcaire compacte
- Large galerie par affouillement dans les calcaires de transition plus fragiles
- Surcreusement traditionnel en petites gorges dans le substratum gréseux
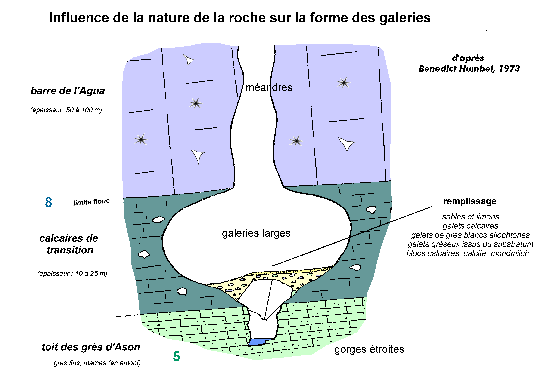
 Version
plus grande
Version
plus grande
Dans le sens longitudinal le jeu des failles qui jalonnent
le parcours fait fluctuer la position de la cavité dans ces différents
niveaux.
La Cueva del Agua se développe essentiellement à la limite de
deux ensembles rocheux distincts ; à la base le complexe gréseux
d'Asón (niveau 5), et au dessus le complexe calcaréo-gréseux
du Haut-Rolacia (niveau 8).
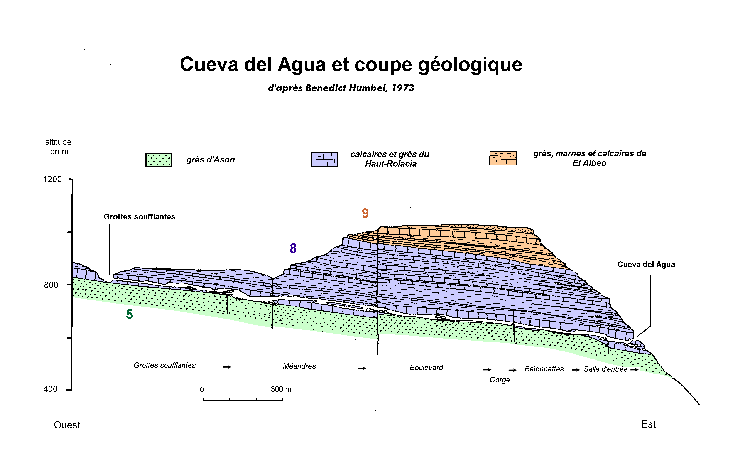
 Version
plus grande
Version
plus grande
Le complexe gréseux affleure au Sud et au Nord du ravin de Rolacia,
dans le Val d'Asón. C'est un ensemble de plus de 500 mètres
d'épaisseur, constitué par des grès divers, des marnes
et de minces bancs calcaires, qui se comporte comme une formation imperméable
pour le karst sus-jacent.
Le complexe calcaréo-gréseux, plus récent, est constitué
par des calcaires massifs, des calcaires argileux et des grès. Il est
particulièrement bien karstifié dans le secteur (Fresca, Salcedillo,
Avellano, Munio, etc…).
Le complexe gréseux d’Asón se caractérise par des
pentes raides entièrement recouvertes de hêtres, d'herbes et
de fougères, tandis que le complexe calcaréo-gréseux
est formé par une alternance de hautes murailles calcaires reliées
les unes aux autres par des pentes vertigineuses recouvertes d'herbe.
Consécutivement à la formation de la ride anticlinale de San
Roque de Río Miera, les terrains ont été déformés,
et plongent aujourd'hui vers l'ESE d'une valeur de 10 à 20°.
Le pendage associé à la fracturation locale induit
un écoulement du ruisseau souterrain d’ouest en est vers le río
Asón. L’érosion a laissé perchée la résurgence
perchée 400 m plus haut que le fond du val d’Asón.
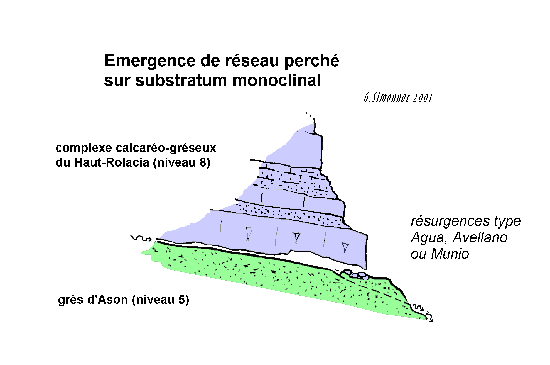
 Version plus grande
Version plus grande
Une partie de l’alimentation du cours souterrain arrive en rive gauche
provenant des escarpements calcaires qui bordent le flanc sud des ravins de
Rolacia.
Pour les arrivées rive droite, très en amont, il faut plus rechercher
l’origine dans des pertes le long de la partie basse du ravin de la
Sota. Les relations éventuelles avec la cueva de la Primavera ou la
cueva Fria, grottes elles aussi de la rive droite demeurent encore de fragiles
hypothèses.
Reste le gros du morceau, ce qui à une époque a probablement
du constituer l’amont des grottes soufflantes et de la cueva del Agua
: le manantial de Cuesta Avellano. Cette grotte est seulement séparée
de la cueva del Agua par l’incision due à l’érosion
du ravin. L’actif qui en sort a abandonné l’Agua pour une
capture par le ravin de Rolacia où il a provoqué une rupture
de pente (recul érosif) au niveau des cascades de Cuesta Avellano.
On peut donc penser qu’à l’origine existait un drainage
depuis la torca del Regato Callejón à l’ouest passant
ensuite par la cueva de Cuesta Avellano et la cueva del Agua.
Haut de page
Historique des explorations
1958
La grotte est visitée une première fois en 1958
par des membres du S. C. Dijon mais aucun compte rendu précis ne permet
de connaître le point extrême de leur exploration. Il est probable
qu’ils n’aient pas dépassé les premiers bassins
que l’on rencontre au début des Baïonnettes.
1961
C’est dès 1961 qu’une équipe du S.C.Dijon
parcourt les ravins de Rolacia jusque vers Cuesta Avellano en signalant les
entrées des grottes soufflantes (n°54) : « Trois heures de
marche sur un sentier étroit, puis dans le lit d’un torrent aux
alluvions de grandes taille, nous permettent de repérer, à l’amont
d’une grande cascade dont les eaux se perdent dans les éboulis,
le long du versant sud, les entrées de cinq grottes. L’une d’elles
s’ouvre par un très grand porche ».
1963
Une équipe de la Société Spéléologique
de Bourgogne retourne à l’Agua et remonte la rivière jusqu’à
la voûte mouillante du Loir soit un parcours de près de 1800
m ce qui est tout à fait remarquable pour l’époque. La
galerie Supérieure donnant accès à la suite du réseau
est également entrevue.
1964
Pour préparer sa thèse de 3° cycle, Claude
Mugnier a décidé de passer pratiquement une année complète
à Asón où il pourra étudier en détail le
karst des massifs environnants. Au cours de ses nombreuses prospections, il
redécouvre en juillet la cueva del Agua et visite la salle d’Entrée
et la galerie Supérieure Fossile.
En août, lors du camp estival du S. C. Dijon, il accompagne une petite
équipe dans la cueva del Agua et ensemble, ils parcourent à
nouveau le conduit principal. Comme leurs collègues de la SSB, les
dijonnais buttent sur la voûte mouillante du Loir. Mais, délaissant
la galerie Supérieure, ils s’engagent dans l’affluent du
Loir, agrandissent plusieurs chatières et remontent le ruisselet sur
près de 200 m sans retrouver le collecteur.
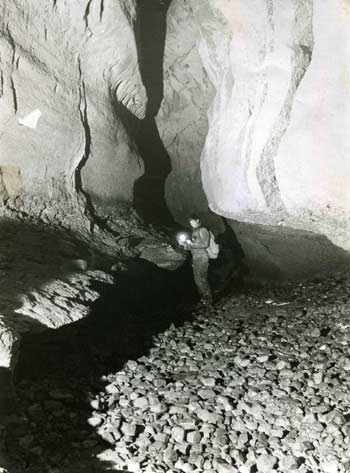
Les Méandres lors des premières
explorations du S.C. Dijon
(Photo Serge Derain)
1965
Les grottes Soufflantes sont explorées par des membres
du S.C. Dijon jusqu’à 300 m de l’entrée. Durant
le même été, ceux-ci entament la topographie de la cueva
del Agua dans la salle d’entrée et la galerie Supérieure
Fossile.
1968
Dans la cueva del Agua, le Shunt est découvert, permettant
aux explorateurs du S.C. Dijon de retrouver la rivière et de parcourir
près d’un kilomètre de nouvelles galeries. Ils s’arrêtent
sur la trémie de la Jonction jugée impénétrable.
Dans sa thèse, Claude Mugnier émet l’hypothèse
d’une jonction avec les grottes Soufflantes, ces dernières se
situant sur le même écran de base (grès d’Asón).
1973
Le S.C. Dijon reprend l’exploration par les grottes Soufflantes.
En franchissant la trémie terminale, il retombe sur le terminus précédent
et établit la jonction avec la cueva del Agua., faisant de cette cavité
la première grande traversée locale. La galerie G-S et le méandre
qui souffle, jusqu’à la cascade, sont explorés. (F. Chavaria,
B. Humbel, J. Lacas, G. Simonnot)
1977
15 août 1977 : Nouvelle incursion du S. C. Dijon ; quelques
prolongements sont découverts dans la galerie des Marmites et le retard
topographique dans ce conduit est rattrapé (730 m topo) (Ph. Morverand
et C. Poète).

Les parois de la Galerie Principale sont constellées
de cupules au milieu desquelles on peut observer une grande variété
de rudistes.
1978
2 août 1978 : L’aval de la galerie du Léthé
est exploré et topographié (150 m) tout comme la rivière
64 dans l’amont de l’affluent du Loir (280 m) (A. Mischler, Ph.
Morverand).
15 août 1978 : Une forte équipe du S.C.D. remonte aux grottes
soufflantes pour terminer l’exploration et la topographie des galeries
latérales en amont de la jonction. L’escalade en amont du méandre
qui souffle est franchie et la topographie complète de l’affluent
est réalisée, tout comme celle de la galerie G-S (190 m) située
sur l’autre rive du conduit principal. La galerie Supérieure
et le méandre de voûte sont également revus. (B. Humbel,
J. Lacas, A. Mischler, Ph. Morverand).
1993
4-5-6 mai 1993 : Après une première visite de
la cavité, une équipe grenobloise du Caf décide de revoir
la partie médiane de la traversée (secteur des Méandres
et du Boulevard). Plusieurs escalades sont réalisées sans grands
résultats pour les premières. Ce n’est que le 3° jour
qu’ils découvrent d’une part, la galerie des Hijas et de
l’autre, après une escalade en libre, 1,1 km de nouveaux conduits
(930 m topo). (B. Lismonde, C. Maingault, H. Schreiner, I. Walckiers, S. Zibrovius).
1994
28 décembre 1993 : Il pleut beaucoup sur la Cantabria
et après avoir équipé les passages aquatiques la veille,
les spéléos du SGCAF reprennent l’exploration entamée
un an plus tôt. La galerie des Boucles, celles de la Porcelaine et des
Balcons sont topographiés et le point haut du secteur (+117 m par rapport
à la rivière) est atteint (V. Bouchiat, Ph. Cabrejas, Ch. Favre-Nicolin,
E. Laroche-Joubert, B. Lismonde, C. Maingault, S. Zibrovius).
30-31 décembre 1993 et 1° janvier 1994 : La même équipe
remonte à l’Agua pour un bivouac de 3 jours à la fin des
Méandres. Les départs du réseau Supérieur sont
vus un à un et dans le réseau Intermédiaire 500 m de
conduits sont topographiés vers la salle du Menhir. Le lendemain, c’est
au tour du réseau intermédiaire d’être revu de fond
en comble. Plusieurs puits communiquent avec la galerie principale. De retour
au bivouac, c’est la crue et le Réveillon se passe en surveillant
le débit de la rivière qui atteint jusqu’à 400
L/s. Le troisième jour l’escalade du puits du Bout avorte suite
à la chute d’un bloc. Le réseau est déséquipé
et l’équipe ressort sous un soleil radieux (V. Bouchiat, Ph.
Cabrejas, Ch. Favre-Nicolin, E. Laroche-Joubert, B. Lismonde, C. Maingault,
S. Zibrovius).
Haut de page
 < galerie de photos sur la cueva del Agua
< galerie de photos sur la cueva del Agua
Accueil Karstexplo
| Karst des Alpes
| Cuevas del Alto Asón