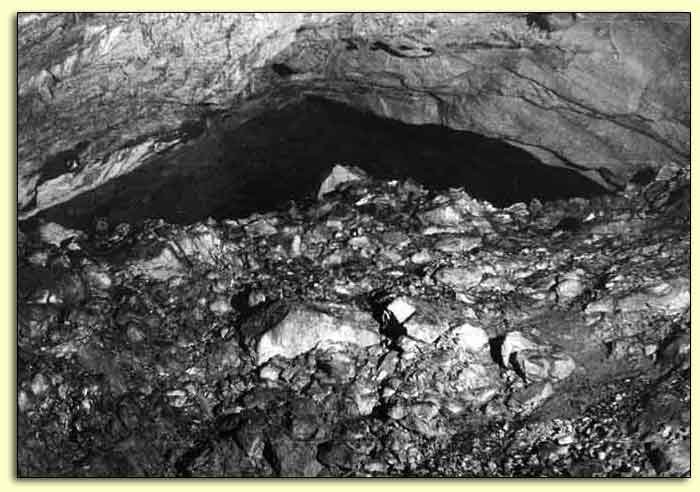Réseau de la cueva Cayuela
(n°84 et 830)
Développement : 16 211 m
Dénivellation : -527 m
La Cayuela est sans doute l'une des cavités
sinon la cavité la plus visitée du massif. Il aurait été
bien difficile aux premiers explorateurs de louper son entrée gigantesque
et l'impressionnant courant d'air qui en sort et ce n'est donc pas un hasard
si le réseau a été l'un des premiers a être étudié.
A 2,5 km du centre d’Arredondo, sur la route d'Arredondo
à Solares, juste avant un virage très prononcé, prendre
la route de Bustablado. 900 m plus loin, à proximité d’une
ferme isolée, s'ouvre vers la gauche un chemin bordé de haies
qui descend en pente douce jusqu'au Río Bustablado (environ 100 m).
Un pont récent, en béton traverse le ruisseau à cet endroit.
De l’autre côté un sentier s’élève
en suivant la lisière de la forêt jusqu’à une étable.
A partir de là il faut longer la haie et continuer vers l’est
à travers un pré en passant à gauche des gros blocs de
rocher. Environ 150 m plus loin, à quelques dizaines de mètres
de l’extrémité du pré, repérer une ouverture
dans la haie qui le limite. Là s’ouvre un sentier qui monte dans
le bois. Une vingtaine de mètres plus haut il faut se diriger plein
est par une sente qui traverse un lapiaz couvert de fougères et de
buissons épineux. On débouche environ 100 m plus loin au milieu
du couloir herbeux balayé d’un courant d’air froid qui
descend de l'orifice de la cueva Cayuela.
La torca ou sima Tonio s’ouvre dans la partie basse d’une prairie,
à proximité de la dernière cabane à l’ouest
de Buzulucueva. On y accède facilement depuis la nouvelle route qui
monte de Bustablado à Bucebrón.
Le réseau possède 2 entrées :
- 84 Cueva CAYUELA
X = 449,665 ; Y = 4791,705 ; Z = 320 m
- 830 Sima Tonio
X = 449,209 ; Z = 4790,609 ; Z = 730 m
Commune : Arredondo
Description
Le Canyon Ouest
Cette partie médiane est impressionnante par ses dimensions.
On traverse plusieurs tronçons successifs.
Le couloir d'entrée
Le porche monumental, de section triangulaire, est encombré
à sa base par un c6ne d'éboulis qui s'élève de
3 à 5 m au-dessus du plancher de la première galerie. Le visiteur
est frappé par les dimensions impressionnantes, en largeur et hauteur,
de ce couloir d'entrée dont la section d'abord quadrangulaire devient
ovoïde La présence de "marmites" de grandes dimensions
au plafond fait penser à une gigantesque conduite forcée. Cette
galerie d'entrée se développe sur 300 m et s'incurve vers le
sud-ouest ; sa pente régulière conduit à -45 m environ
(par rapport à la Cayuela). La progression est brusquement interrompue
par un premier à pic.
On atteint un puits (P.12m) temporairement arrosé qui donne accès
à une galerie de 2 à 3 m de large aux parois verticales qui
conduit à la galerie Nord. En remontant la galerie on gagne le canyon
Ouest proprement dit. Le P.12 et la remontée peuvent être court-circuités
par une grande vire à main gauche (équipement).

La monumentale galerie d'entrée de la
Cayuela.
Le grand canyon Ouest
Quelques mètres de montée font déboucher
dans une dépression assez large, ébouleuse, où scintille
parfois un petit lac. Quelques dizaines de mètres plus loin la galerie
parait se dédoubler. La portion inférieure a la forme d'un canyon
tandis que la partie supérieure a un profil en "trou de serrure"
que l'on peut observer d'un balcon situé en aval. Les deux portions
communiquent formant un puits de 30 m. Au-delà la galerie s'élargit
notablement en une sorte de salle ascendante remplie d'éboulis de grande
taille. Puis le canyon se rétrécit sans perdre de sa hauteur.
Cent mètres plus loin on passe sous "l'arche", énorme
bloc coincé entre les parois du canyon à une dizaine de mètres
de hauteur.
Une cascatelle le long de la paroi ruisselle sur un éboulis barrant
le canyon : c'est tout ce qui traduit la présence du boulevard par
où débouche, dans le haut du canyon, le réseau Sud. Après
cinquante mètres de progression sur un plancher calcifié un
courant d'air sensible trahit le départ de la galerie Sud peu important
(1,5m x 3) et masqué par deux gros blocs. A partir de ce point la physionomie
du canyon change : le fond est encombré d'un chaos de blocs de grande
taille, la section s'élargit, des galeries supérieures sont
observées et le plafond en demi voûte, incliné vers le
nord, s'abaisse progressivement. On est dans la salle de "La croix Blanche"
dont le nom vient d'une croix gravée sur un bloc à l'allure
de pierre tombale ; manifestation de l'humour noir d'un visiteur ? Aboutissent
à cette salle divers petits conduits dont le labyrinthe ouest donnant
sur le réseau actif.
Le petit canyon Ouest
La salle de la « Croix Blanche » fait la transition
entre grand et petit Canyon, celui-ci est de taille plus modeste en largeur.
Son aspect change continuellement : succession d'éboulis et de coulées
de mondmilch. Parfois le chemin se rétrécit à un passage
"étroit" entre deux énormes blocs enchâssés
dans l’argile. On rencontre plusieurs petits bassins alimentés
par des cascatelles tombant du plafond (>35m). Lorsque le plafond se relève
brusquement on aperçoit des vires et des orifices de galeries supérieures
qui apparaissent difficilement accessibles. Une fois la dernière mare
franchie la progression s'effectue sur un plancher encombré de blocs.
A une centaine de mètres du fond, dans la paroi gauche et légèrement
en hauteur, s'ouvre le conduit qui aboutit au puits Buffard ; après
un ultime élargissement, la galerie est obstruée sur toute sa
largeur par une coulée stalagmitique ne laissant aucune possibilité
de continuation. Nous sommes alors à 1020 m de l'entrée et à
la profondeur de -28 m. Sous le concrétionnement un petit dédale
de galeries ne permet pas, lui non plus, de dépasser le verrou terminal.
Le puits Buffard
L’accès est un diverticule d’une dizaine
de mètres ; il donne sur une verticale de 40 m axée sur une
diaclase. Au fond on rejoint un important actif de ce qui paraît être
le collecteur principal du réseau.
En amont on court-circuite une partie siphonnante d’une vingtaine de
mètres par une étroite diaclase ; on rejoint une jolie galerie
parcourue par des rapides serpentant entre les lames de roche épargnées
entre les axes de fissuration. Une cheminée étroite et impénétrable
communique avec le petit ensemble de galeries au fond du Canyon Ouest. La
pente s’accentue encore avec quelques cascatelles et le conduit diminue
à l’approche d’une trémie infranchissable (à
150 m du puits) et qui exhale un petit courant d’air. L’actif
est remonté de 28 m en dénivelé ce qui est beaucoup pour
le collecteur sur une distance de seulement 100 m.
En aval, après quelques profonds bassins, on suit l’actif établi
sur des diaclases (rapides) ou des joints de strates inclinés jusqu’à
un siphon (190 m / puits et –4 en dénivelé).
Le Labyrinthe Ouest
Dans l'éboulis de la Salle de la Croix Blanche, près
de la "Croix", un conduit donne accès à un labyrinthe
incliné et très complexe qui permet de rejoindre avec difficulté
un cours actif (rivière du Labyrinthe). L’amont incomplètement
exploré présente un plan d’eau tandis qu’en aval
on peut suivre le cours d’eau de façon bien plus agréable
sur une centaine de mètres. Une série de petites cascatelles
aboutit à un très beau siphon. Très court, ce dernier
mène à 280 m de galeries peu évidentes où l’on
perd le collecteur. L’amont de la cueva Cubiobramante,
résurgence du système, n’est pourtant plus très
loin. Le débit semble correspondre à la rivière du puits
Buffard mais le curieux décalage en plan des deux tronçons de
rivière laisse perplexe. Légèrement en amont du Labyrinthe
existe dans le Canyon Ouest deux accès à un morceau de cours
actif (non topo).

La rivière du Labyrinthe, peu avant le S1 aval.
La galerie Nord
Au pied du P.12 de la galerie d’entrée (-65 /
Cayuela) cette ancienne galerie de capture des eaux du Canyon n’est
plus que faiblement active, alimentée par quelques pisserottes de la
grande galerie.
Un premier ressaut de 4 m oblige à équiper dès le départ
puis, trente mètres plus loin, trois puits s’enchaînent
(P.10, P.9, P.10). Un conduit de petites dimensions mène à une
laisse d’eau siphonnante (-117 / entrée de la Cayuela et point
bas actuel du réseau -527). Au niveau du dernier P.10 des diaclases
aboutissent aussi sur siphon.
Les galeries supérieures
La galerie du fond
A 70 m du fond du petit canyon Ouest, contre la paroi Sud,
s'ouvre à la voûte un orifice relativement étroit débouchant
dans le plancher d'une grosse galerie. Remontée sur 60 m elle est colmatée
par une coulée stalagmitique. En aval elle retombe, par plusieurs balcons
sur le petit canyon.
La galerie de la Croix Blanche
Elle est limitée à ses deux extrémités
par des balcons l'un au-dessus de la salle de la Croix Blanche, l'autre au-dessus
du petit canyon. Il s'agit d'une galerie sableuse, abondamment concrétionnée
qui est, en son milieu, occupée par des blocs impressionnants enracinés
dans le sable. Le plafond plonge vers le Nord puis à l'extrémité
la galerie prend l'allure d'un canyon. Au nord et à l'ouest deux diverticules
conduisent à des chatières étroites.
Galerie de l'Arche
Entre l'Arche et la galerie de la Croix Blanche existerait
une galerie supérieure d'une centaine de mètres de longueur
( ?).
Le réseau Sud
Ce grand réseau est divisé de façon quelque
peu arbitraire en quatre parties, pour la commodité de l'exposé.
Ce sont successivement la galerie Sud et le Boulevard, les salles du Carrefour,
le complexe de la salle du Bivouac, la galerie du 10 Août.
La Galerie Sud et Le Boulevard
Repartons du grand canyon Ouest. Après son porche bas,
dans les éboulis, la galerie Sud a l'aspect d'une diaclase, relativement
étroite, tapissée d'argile puis de cailloux. Après un
ressaut, fait de roche découpée, s'ouvrent deux conduits. Le
plus large d'entre eux mène à une salle latérale partiellement
remplie de blocs recouverts de sable fin. Le plus étroit, de type conduite
forcée, donne accès à une salle de même aspect
que la précédente. Les deux salles communiquent entre elle par
deux conduits se rejoignant par un petit puits. Cette disposition, en circuit
fermé prédispose à des parcours en ronds lorsqu'on ne
connait pas la cavité. Au fond de la salle se trouve en hauteur, une
diaclase qui après quelques 30 m donne accès à une petite
salle basse couverte de coulées calcitiques déposées
par un filet d'eau descendant d'une lucarne du plafond. C'est le point ultime
de la première exploration (1959) à environ 200 m du début
de la galerie. Derrière la lucarne une chatière sinueuse de
plusieurs mètres conduit d'abord à une base da puits, sur la
gauche, et ensuite à une salle encombrée de blocs où
le plafond s'élève notablement et brusquement (800 m, -43).
De ce point on peut atteindre la suite du réseau de deux manières.
Ou bien on emprunte une chatière au fond de la salle pour déboucher
dans la salle du Carrefour-basse, ou bien on monte, le long de la paroi gauche
de la salle, par « l’escalier » pour emprunter un couloir
assez court, de section triangulaire, tapissé de mondmilch et rejoindre
la salle du Carrefour-haute. A quelques mètres de là une montée
de 3 à 5 m permet d'atteindre le Boulevard.
Il s'agit d'une belle galerie horizontale d'une largeur de 10m en moyenne,
d'une vingtaine de mètres de hauteur, dont le sol est de sable ou de
mondmilch d'où émergent quelques rochers. D'abord orienté
vers le Nord-est et quasi rectiligne sur ses 120 premiers mètres le
Boulevard fait ensuite un brusque coude à angle droit et s’infléchit
en direction du Nord-Ouest. Un diverticule sur la gauche conduit à
une étroite galerie Nord-Sud qui communique par un puits avec la galerie
Sud. Revenons au Boulevard, il reprend sa direction primitive s'étant
élargi considérablement. Le sol est une plage de mondmilch avec
quelques flaques d’eau. Le plafond s'abaisse rapidement puis se relève.
Un nouveau changement de direction et c'est l'arrivée sur le réseau
aval (quelques mètres en aval de l’Arche), par 3 "portes"
dont la plus importante se situe au dessus de l’éboulis du grand
canyon Ouest ; on rencontre là un petit ruisseau alimenté par
une cascatelle tombant du plafond.
Les Salles du Carrefour
Ces deux salles largement coalescentes forment un vaste ensemble
fortement pentu grossièrement orienté Est-Ouest. Le plancher
est constitué par un chaos de blocs, certains de taille impressionnante,
souvent instables, ce qui laisse à penser que les blocs occupent plus
de la moitié du volume des deux salles. Comme leurs noms l'indiquent
il s'agit d'un important carrefour dans le réseau de la Cayuela. Outre
l'arrivée de la galerie Sud et du Boulevard on reconnait p1usieurs
départs.
Au point le plus bas une galerie descendante aboutit a un cours d'eau. Celui-ci
s’engouffre dans une chatière. Quelques mètres de progression
très pénibles, car les restes des fossiles dégagés
et façonnés par l’érosion forment des arêtes
tranchantes, permettent d'atteindre la salle des 5 de belles dimensions. Celle-ci
s'allonge en direction Nord et se prolonge, au-dessus d'un surplomb de 5 m,
par un large couloir qui se termine brusquement 50 m plus loin. Ce petit réseau
semble parallèle à la galerie Sud (non topographié).
Vers le sommet de la salle du Carrefour-basse part, en direction Sud-Sud-Ouest
le méandre de la galerie Vespasien. La salle du Carrefour-haute donne
accès après une montée courte dans un éboulis
de gros galets ronds à une large galerie se dirigeant vers le Sud,
qui à son extrémité, 40 m plus loin, est tapissée
de mondmilch extrêmement glissant. Cette particularité a donné
à ce conduit, le nom de galerie de la Patinoire.
Le complexe de la salle du Bivouac
La salle du Bivouac est le point de rencontre d'un ensemble
complexe de galeries plus ou moins anastomosées de sorte qu'il est
possible de l'atteindre par plusieurs voies.
A partir de la Patinoire deux chemins mènent à la salle du Bivouac.
La galerie du Balcon au plancher jonché de blocs de toutes tailles,
aboutit, après une courte descente en varappe et un passage bas, au
Balcon qui domine la salle.
Vers le Sud-est le passage est une sorte de tunnel rempli de brouillard. La
condensation est due à l’arrivée des gros courants d’air
du réseau « Gloria ». A un embranchement le "tunnel"
se poursuit dans la même direction, la pente s'accentue notablement
et on arrive dans une petite salle dont le fond est colmaté par du
sable. La seconde branche est une galerie de dimensions plus modestes abondamment
concrétionnée : la galerie des Scies. Les concrétions,
de type stalactite, sont longues et plates, orientées dans le sens
du vent (comme les aubes d'une soufflerie). Elles possèdent un canal
axial, par où chemine l'eau, encore fonctionnel (non colmaté)
pour certaines d'entre elles. De ce tronc axial un grand nombre d'excroissances
ont poussé dans le sens du courant d'air. Réunies à leur
base, elles ont fini par former une lame au bord effrangé évoquant
étonnamment la scie utilisée autrefois par les scieurs de long.
Immédiatement derrière une herse stalactitique commence la salle
du Bivouac.
La galerie Vespasien et ses annexes
Bien moins « royale » que les précédentes
cette voie part de la salle du Carrefour-basse. La galerie Vespa¬sien
est d'abord un couloir au plancher calcifié qui s’élargit
en une sorte de salle où s'épanche une coulée calcitique.
Une plage sableuse en occupe le fond. Quelques mètres plus loin la
galerie est barrée par un entonnoir creusé dans le roc noir,
arrosé par une cascatelle. A partir d’ici la galerie prend un
aspect extrêmement tourmenté, un méandre en conduite forcée.
Des boyaux latéraux partent dans toutes les directions de l'espace.
Quelques jonctions ont été réalisées avec le puits
de la Fenêtre (dans la galerie montante), avec le puits Berger (à
la sortie de la galerie des Scies, avec un puits situé dans la galerie
du 10 Août. La descente du puits de la Fenêtre a conduit à
un réseau actif dont les relations avec la galerie Vespasien et la
Salle du Bivouac restent encore à préciser. Un embranchement
permet deux options :
-Vers le Sud, une étroite diaclase, très travaillée par
l'érosion, mène à une nouvelle bifurcation. Direction
Nord un véritable toboggan de section irrégulière conduit
à une petite salle. Deux petits ressauts font déboucher dans
une galerie ou sol argilo-sableux qui arrive dans la galerie Montante. Vers
le Sud-ouest, la diaclase se rétrécit è nouveau. Un bruit
d'eau, très net, monte entre les blocs ; 150 m plus loin l'étroit
conduit marque le terminus des explorations des années 60.
La rivière Vespasienne amont est retrouvée à partir de
la galerie des Bottes (100 m) qui démarre sur un côté
de la galerie Montante. Le cours actif peut être remonté sur
un demi-kilomètre en direction du sud-ouest
-Vers l'Est un couloir bas et court donne dans une petite salle qui est franchie
par une vire étroite. Au-delà on rencontre un méandre
fossile dont les marmites sont remplies d'argile. Quelques dizaines de mètres
plus loin un puits arrosé de 25m constitue la perte du ruisseau du
Méandre venant du Sud. Au fond le conduit siphonne immédiatement.
La galerie Vespasien apparaît donc comme le conduit abandonné
prolongeant le méandre actif venant du Sud.
La Salle du Bivouac et ses annexes
Près du débouché de la galerie des Scies,
dans la paroi Nord, s'ouvre le puits Berger (dont le fond communique avec
la galerie Vespasien) ; en contrebas, la Salle du Bivouac étale sa
plage sableuse, entrecoupée de gros blocs, qui descend rapidement sur
un cours d'eau temporaire (en liaison probable avec le réseau Gloria).
Au fond de la salle un siphon s'amorce en période de crue ou en cas
d'orage. Des traces montrent que l'eau peut monter de 3 m. Dans la partie
Est de la salle s’amorcent quelques diverticules. L’un d'eux est
en relation avec le puits de la Fenêtre et vraisemblablement avec le
puits Berger. Au Nord-Ouest un éboulis de gros blocs permet d'accéder
à la galerie Montante (avec un regard sur le puits de la Fenêtre).
La galerie passe à un petit canyon qui se dirige vers le Sud et par
une courte escalade rejoint le départ de la galerie du 10 Août.
La galerie du 10 Août et ses annexes
La Galerie du 10 Aout
La Grande Galerie du 10 Août démarre au dessus
de la salle du Bivouac ; elle présente une succession d’élargissements,
où le sol est sableux et de rétrécissements, où
apparaît le rocher. Le plus caractéristique est le rétrécissement
du "Méandre". La section de la galerie est celle d'une conduite
forcée recreusée par la rivière qui coule aujourd’hui
20 m plus bas. Dans toute cette zone, le plafond de la galerie, assez élevé,
est orné de « scies ».
Plus loin, tandis que l'échappée sur le réseau actif
se colmate et que s'estompe le bruit de l'eau, s'ouvre une vaste rotonde au
plancher argilo-sableux. A l'Ouest apparaît une petite diaclase bordière,
à l'Est une galerie modeste se termine sur une trémie. Vers
le Sud après un rétrécissement, avec un regard ver la
rivière, la galerie s'élargit de nouveau. Elle est presque entièrement
barrée par un énorme éboulis venant de la voûte
Ouest qui constitue une formidable trémie. Coté Est une galerie
sableuse s’élève en pente douce jusqu’à une
trémie infranchissable. Sur le plan ce conduit apparaît en communication
avec une galerie fossile du réseau « Gloria ». La galerie
du 10 août se termine vers l'Ouest, par un diverticule sableux. Au-dessus
se placent des balcons donnant dans le réseau du Coton. Enfin au Sud,
s’ouvre l'Antichambre.
L'Antichambre
C'est ainsi qu'a été baptisé un grand
canyon de plafond élevé. Le plancher est encombré de
blocs recouverts d'un "enduit" noir et de calcite en choux-fleurs.
Sur le coté Ouest, s'ouvrent deux orifices. Le premier, au pied de
la paroi, donne accès à la rivière, l'autre, au sommet
du canyon, va au réseau du Coton. Plus loin, le canyon est occupé
par un gigantesque éboulis qui s’élève en pente
forte, sur près de 40 m, jusqu'à la salle Guillaume. Le volume
de cet éboulis est tel que vers son sommet il atteint presque le plafond
de l'Antichambre déterminant à ce niveau une sorte de trémie,
la « Tuyère » d’où souffle un violent courant
d’air.
La rivière du Méandre
On l’atteint à partir du rétrécissement
du Méandre par une descente de 20m à équiper mais il
existe des passages dans les blocs qui permettent une descente en «
libre ». L’actif circule au fond d'un méandre étroit
(1 à 2m de large). En aval l'eau passe dans des marmites, partiellement
comblées, avant de chuter en cascade dans un puits-perte déjà
signalé (galerie Vespasien). En amont le méandre se dirige vers
le Sud. Sur le fond le ruisseau a dégagé et modelé la
roche laissant quelques blocs trop gros pour être entraînés
par les eaux. Dans cette direction le méandre se rétrécit
jusqu’à une trémie infranchissable. Heureusement un passage
en hauteur permet de contourner l'obstacle. Plus loin la rivière coule
dans une galerie basse, semée d'éboulis puis après quelques
étroitures, qu'il a fallu déblayer, dans un petit méandre
étroit jusqu'à une petite salle.
Le réseau du Coton
Dans l'Antichambre on accède par une vire et un plan
incliné à un large balcon, taillé dans la paroi du canyon,
d'où partent deux conduits. Celui de gauche après s'être
dédoublé monte. Jusqu’à une trémie. C'est
une galerie de section semi-circulaire où abondent les placages de
"coton". Le conduit de droite passe rapidement sous la galerie précédente
puis forme un petit labyrinthe se développant au-dessus de la galerie
du 10 Août avec laquelle il communique par plusieurs puits. Divers boyaux
conduisent à un petit canyon limité par deux puits qui rejoignent
la galerie du 10 Août.
Le réseau Gloria
Sous ce vocable est regroupé un ensemble de 3 km de
galeries qui se développent parallèlement au réseau Sud.
Dans la salle Guillaume, il faut rester au bas de l’éboulis et
chercher à l'est un vaste puits que l'on passe en vire sur la gauche
pour atteindre la galerie Est. On la suit au plus évident sur trente
mètres jusqu'à un col, par de petits ressauts remontants. La
galerie Est continue à droite ; à gauche on domine une vaste
dépression sans suite. Le passage clé est à chercher
en face, entre les blocs, au pied d'une petite cheminée. En restant
au plus près de la paroi, on trouve une galerie étroite et déclive
qui mène à une petite salle percée par un puits souffleur
(puits de 23 m). Celui-ci nous dépose dans la vaste salle du Dijonnais.
On descend dans le fond de la salle, vers une cascade, à gauche de
celle-ci on remonte dans des blocs boueux avant de descendre le ressaut de
5 m juste derrière ; le méandre Gloria débute par une
étroiture verticale désobstruée dans le fond d'une petite
salle. Après la chatière, on descend un ressaut de 6 m (pas
d'équipement) vers un mince filet d'eau, la rivière Gloria,
que l'on va suivre presque jusqu'à son siphon aval. Le cheminement
dans le méandre n'est pas toujours aisé : cent mètres
après le ressaut de 6 m, il faut grimper pour éviter un rétrécissement
et redescendre de l'autre côté par un puits de 11 m (puits de
l'Escarbille). On chemine ensuite le plus souvent au sol et on descend un
puits de 8 m (puits du Tamponnoir). Par une galerie basse, on atteint une
petite salle bien concrétionnée : une barrière de calcite
oblige à se glisser au ras de l'eau. Ce passage est heureusement court
et on quitte la rivière tout de suite après par une large galerie
en hauteur. Il faut grimper un ressaut de 4 m (ou le shunter par un boyau
à droite) et une conduite forcée amène au sommet d'un
ressaut.
Dans cette zone, le réseau devient labyrinthique, les départs
sont nombreux. Il faut descendre le ressaut (6 m) et, en restant bien à
droite le long de la paroi, descendre par une galerie déclive jusqu'au
sommet d'une pente de sable fin. En bas coule la rivière ; à
gauche un méandre nous mène dans une petite salle ronde, la
salle A. On prend le méandre qui s'ouvre à droite. Après
une cinquantaine de mètres, il recoupe la rivière. On descend
en désescalade (ressaut de 5 m), et on remonte tout de suite de l'autre
côté à travers d'étranges lames d'érosion
pour éviter un bassin profond. En suivant, en gros, la même direction
dans une galerie large, basse et boueuse, on trouve une petite conduite forcée
sableuse qui descend à gauche vers la rivière par un ressaut
de 3 m.
Il n'y a plus qu'à suivre l’actif vers l'aval sur une centaine
de mètres pour déboucher dans la vaste galerie des Invités.
L’eau part à gauche vers un siphon en liaison probable avec la
salle du bivouac. A droite la suite est soulignée par le courant d'air.
Un rétrécissement oblige une dernière fois à se
baisser. Derrière, la galerie retrouve une belle section de conduite
forcée, inclinée à 45°. On monte sur 50 m de dénivelé
jusqu'à un col, et on redescend à gauche un grand toboggan assurant
la jonction avec le Tunnel tout près du départ de la galerie
des Scies.
A partir du col on peut poursuivre dans le méandre de la Souris qui
se développe 80 m au dessus de la grande galerie du Boulevard.
La salle Guillaume, les galeries Est et Tantale
La Salle Guillaume
Une fois passé la "tuyère" l'éboulis
se poursuit tandis que le plafond se relève brusquement. Un petit ressaut,
du à des blocs de très grande taille, marque le début
de la salle. Au delà, les parois divergent rapidement, alors que l'éboulis
ne cesse de monter et le plafond de s'élever. Tous les blocs sont recouverts
d'un enduit pelliculaire, noir, ce qui contribue à donner un aspect
sinistre à ce lieu. P1us avant, en direction du Sud-sud-ouest, une
dépression est creusée dans l'éboulis. Dans cette "doline"
tombe du plafond une cascatelle. La monotonie de la marche ascendante dans
l'éboulis est rompue par un second accident : un replat correspondant
au resserrement de la salle. On aboutit enfin à une sorte de plateau
(+ 160) d'où l’on voit les parois quasi verticales de la salle.
De là on atteint l’extrémité assez rapidement par
une descente très raide mais beaucoup plus courte que le montée.
Le gigantisme de la Salle Guillaume pourra être apprécié
par les chiffres suivants : longueur 302 m, largeur maximale, 120 m, largeur
minimale 65 m, hauteur maximale au-dessus de l’éboulis estimée
à 60 m. On n'a que peu de données sur l'importance de l'éboulis.
Compte tenu du profil de la salle et de la taille des blocs (plusieurs sont
énormes : "gros comme des maisons") on peut estimer qu'il
occupe vraisemblablement près des 2/3 du volume de la Salle Guillaume.
Dans la première partie de la Salle Guillaume, au pied de la paroi
de droite, s'ouvre une petite galerie de section semi-circulaire tapissée
d’un épais manteau de "coton", qui se ferme par une
trémie. Le franchissement de celle-ci donne accès à une
salle de dimensions moyennes et haute de plafond : la salle du Coton. Coté
Nord un grand éboulis de blocs et de graviers cimentés par une
argile humide monte jusqu'au plafond. Côté Sud un système
labyrinthique de galeries rejoint le réseau du Coton.
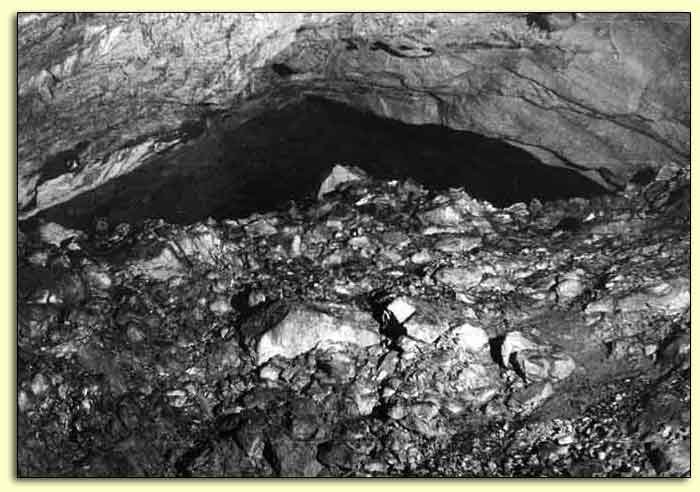
La
salle Guillaume lors des premières explorations. La photographie a
été prise depuis l'entrée de la salle en direction du
fond.
La galerie Est
Dès le début cette galerie est barrée
par un puits au fond duquel partent deux conduits divergents colmatés
par des trémies. Une fois le puits franchi par une vire la progression
continue. Les orifices du labyrinthe s’ouvrent dans la paroi Nord. C’est
également à ce niveau que démarre le réseau Gloria.
La galerie Est se poursuit sur 200 m à travers les éboulis par
une succession de montagnes russes puis elle se divise en trois branches dont
deux se rejoignent rapidement. Après un puits ascendant et une chatière
la galerie se termine dans une salle de dimensions moyennes.
La galerie Tantale
A l’extrémité de la salle Guillaume démarre
une galerie assez large quoique de hauteur moyenne par où paraît
s’être engouffré une partie du grand éboulis de
la salle. Aussi sur plus de 200 m la galerie n’est qu’une suite
de montagnes russes parmi les chaos rocheux, sous une voûte assez irrégulière.
La plupart des blocs sont recouverts de l’enduit noir, déjà
signalé dans la salle ; certains sont tapissés d’un concrétionnement
en « choux-fleurs ». Après ce parcours accidenté
mais grosso modo rectiligne, le conduit s’incurve brusquement vers le
sud tandis que sa forme change. Après un étroit passage entre
la paroi et un mur stalactitique la galerie s’élargit pour former
la salle de la Vierge.
Après la salle de la Vierge part un canyon relativement étroit.
Au niveau d’un coude, derrière un énorme bloc, démarre
une galerie de type méandre. La galerie principale tourne plusieurs
fois à angle droit puis se rétrécit. Le plafond s’abaisse
brusquement et la taille des blocs jonchant le plancher s’amenuise.
Une chatière apparaît, parcourue par un violent courant d’air.
Une petite salle se trouve ménagée entre les blocs d’une
trémie. Dans tout ce secteur plusieurs diverticules ont fait l’objet
de dures séances de travaux qui se sont soldées par un échec,
et cette trémie demeure un véritable supplice de Tantale pour
le spéléologue.
La torca Tonio
L'entrée de la torca Tonio s'ouvre en contrebas des
cabanes de Buzulucueva en bordure d'un pré. C'est un trou étroit
qu'il faut rechercher sur le flanc d'une doline. La plupart du temps, le trou
est recouvert d'une dalle pour éviter aux animaux d'y tomber. À
l'entrée, le courant d'air est étonnant : il ronfle quand il
fait suffisamment chaud à l'extérieur.

L'entrée de la torca Tonio.
Les premiers puits sont assez étroits (15, 18 et 9 m),
presque desséchés par le courant d'air chaud venu de l'extérieur.
Les parois au début sont blanches et recouvertes de mondmilch.
À -40 m, on débouche sur le puits de 48 m, beaucoup plus vaste.
A ce niveau on pourrait croire que le chemin sera direct pour rejoindre la
Cayuela mais ce puits conduit ensuite à une succession de crans verticaux,
bouchés plus en profondeur (-228). Aux deux tiers du puits (vers -35),
après un pendule facile vers la gauche, on prend pied sur une plateforme
encombrée de blocs. Une courte escalade de 4 m, suivie d'une petite
descente et d'un puits de 10 m, conduit à la diaclase de 13 m qui est
étroite. Il faut se décaler de 5 m en opposition en restant
au plafond. Arrivé au spit, on descend verticalement la diaclase étroite.
La suite est un peu boueuse. On descend en rappel le puits vidé, clef
de la traversée et sous le gros bloc on remonte la diaclase voisine,
on arrive sur un P.11 que l'on ne descend pas, mais en continuant à
traverser on rejoint, par un boyau, une petite salle. Un rappel amène
sur une belle margelle dominant un vaste puits (P.55). Les parois sont décorées
de "coton" constitué de fibre de gypse qui se tasse comme
de la neige. On ne descend que sur 36 m et on attrape le puits parallèle
en pendulant. Il est un peu mondmilcheux.
A partir de là, les puits se succèdent sans problème
Ils n'ont pas l'ampleur des plus grandes verticales des Cantabriques, mais
ils sont agréables et coupés en petits tronçons (8, 6,
19, 13, 15, 6, 6, 18 et 22). À - 200 on débouche dans une vaste
diaclase. À - 230 un tas de gros blocs a obstrué le puits et
il faut se glisser au travers pour atteindre le petit méandre très
ventilé. La roche en est un peu gréseuse. Ce méandre
débouche de façon inattendue au toit de la salle Guillaume par
un trou minuscule, absolument invisible du bas. Suivent 20 m de descente dans
un vide complètement noir où les parois s'enfuient de tous les
côtés. En bas, à -282, on prend pied dans la pente d'un
éboulis énorme qui occupe toute la partie nord de la salle Guillaume.
Géologie, hydrologie
Le réseau de la Cayuela se développe dans les
calcaires (niveau 3-4) du flanc nord de l’anticlinal de Socueva. Comme
dans tous les grands réseaux des secteurs 1 et 2 du massif de Porracolina
on retrouve des niveaux de méga-galeries inactives témoignant
d’un ancien drainage subhorizontal entre des altitudes de 450 à
300 m. Les énormes conduits ont été très affectés
à postériori par le rejeu de failles probablement préexistantes
(néotectonique ?). C’est particulièrement net au niveau
des terminus sud où les fractures qui soulignent l’anticlinal
de Socueva, orientées N60°, ont provoqué d’énormes
trémies qui mettent un terme aux espoirs des spéléologues.
Une des failles principales (faille de Bucebron) passant par la sima Tonio
coupe la Cayuela au niveau de la salle Guillaume dont elle est probablement
à l’origine.
Que ce soit pour le drainage ancien ou les écoulements actuels on peut
schématiquement retrouver deux directions privilégiées
dans l’organisation du réseau :
Une alimentation venant du sud. Elle est actuellement représentée
par l’actif du réseau Gloria et la rivière du méandre
sous la grande galerie du 10 août.
Le bassin d’alimentation sud actuel s’étend grossièrement
de Buzulucueva au canal de Calles.
La proximité en vis-à-vis des grandes galeries de la sima del
Cueto et de la Cayuela pourrait laisser à penser que les paléo-écoulements
avaient une aire d’alimentation plus étendue vers le sud et de
l’autre côté de la ride anticlinale de Socueva. La structure
géologique générale dans cette masse compacte des calcaires
de Peña Lavalle ne semblerait donc pas, à ce moment là,
avoir influé sur le drainage qui a été orienté
vers le niveau de base représenté par le rio Bustablado ancien.
Cette hypothèse séduisante pour le spéléologue
qui rêve de jonctions est cependant peu évidente : l’altitude
élevée des niveaux gréseux de Socueva (niveau 1 ou formations
de río Yera) parait constituer une barrière, même à
l’altitude des galeries fossiles. A débattre
Une alimentation ouest/sud-ouest plus importante représentée
par le collecteur circulant sous le canyon Ouest.
Il semble bien que l’origine longtemps recherchée soit en grande
partie le collecteur de la torca de La Canal (rio Eulogio). Nous renvoyons
donc à l’étude de cette très importante cavité
du secteur 2.
Le bassin supposé pour l’instant remonte vers le sud-ouest en
passant par Los Machucos, Las Pasadas , pour atteindre vraisemblablement le
secteur de Calseca tout près du Rio Miera. Les têtes de réseau
sont donc éloignées de quelques 7 km à vol d’oiseau
de la résurgence du système : la Cubiobramante
(voir n°85 et 275)
Historique
La galerie d'entrée de la Cayuela est connue depuis
des temps immémoriaux : les vestiges préhistoriques qui y furent
découverts (actuellement au Musée Préhistorique de Santander)
en font foi. Dans ces conditions, il est difficile de dater les premières
incursions dans la cavité.
1954
Dresco, Derouet, Dury et Nègre, au cours de leurs expéditions
bio spéléologiques, signalent l’existence de bois pourris
au fond du puits de 12 m ainsi que des traces de corde sur la margelle. Il
ne paraît donc pas invraisemblable qu’une partie au moins du Canyon
Ouest ait été explorée auparavant.
1958
Le canyon ouest est visité dans son intégralité
et le petit réseau nord près de l’entrée est exploré
par le SC Dijon.
1959
Un plan est publié (in de Loriol 1959) indiquant bien
le réseau Sud mais hélas mal placé dans la Canyon d’entrée.
Dès cette époque il est question d’une éventuelle
relation avec des dolines repérées sur photos aériennes
du côté de Buzulucueva.
1964
Avril 1964 : découverte de la galerie
d’accès au puits Buffard.
Août 1964 : descente du puits Buffard et exploration
de la rivière (avec un canot !). Dans le réseau du Labyrinthe
de la galerie Ouest un morceau de cours actif entre deux siphons est atteint.
1967
5 août 1967 : le franchissement de deux
étroitures au fond de la galerie Sud, parcourue en 1958 et enfin retrouvée,
conduit les explorateurs à la salle basse du Carrefour. Découverte
de la galerie Vespasien et de la salle des Cinq.
10 août 1967 : désormais la voie est libre ;
à partir des salles du Carrefour découverte du Boulevard mais
surtout, vers le sud, des galeries des Scies, du 10 août et avancée
jusqu’à la salle Guillaume.(1560 m de première) (J.H.
Delance, R. Perriaux, J.P. Pieuchot, A. Poinsot, J.M. Rabeisen).
16 août 1967 : Une nombreuse équipe gagne la
salle Guillaume et découvre la galerie Tantale. Une pointe est poussée
jusqu’à la trémie (Castin, Lacas, Rabeisen).
1968
Août 1968 : exploration de la galerie
Est sur 200 m et d’une partie du Labyrinthe Sud. Reconnaissance de la
grande galerie supérieure du Canyon Ouest.
Noël 1968 : un camp de 4 jours est organisé par
le SC Dijon et le SC Paris. Exploration du fond de la galerie Est, du Labyrinthe,
de la salle du Coton.
1970
Eté 1970 : un camp de 7 jours ( ! !)
est implanté à la salle du bivouac. Mis à part quelques
compléments d’exploration (réseau moyen, escalade dans
la galerie Tantale) les résultats sont plutôt médiocres.
Il semble que cette valeureuse équipe ait été surtout
performante sur le plan gastronomique.
On peut s’étonner, qu’à quelques mètres seulement
du bivouac, une grosse galerie facilement accessible n’ait pas été
visitée alors qu’elle est balayée par très fort
courant d’air lui même signalé par une superbe zone de
brouillard. L’étonnement tourne à la stupéfaction
quand on sait que des centaines de spéléologues vont passer
devant pendant trente ans sans sourciller le moins du monde !
1972
Eté 1972 : exploration vers l’amont
du ruisseau actif du méandre du 10 août.
1983
12 juillet 1983 : nous recherchons la rivière
du Labyrinthe Ouest. Dans un premier temps nous ne retrouvons pas les trente
mètres de plan d’eau signalés en 1964, mais par contre,
guidés par le bruit, nous découvrons vers l’aval une centaine
de mètres d’une belle rivière (topographie en 1986). Pendant
ce temps l’un d’entre nous (Michel Dorey), qui avait peut-être
enfin trouvé le plan d’eau 64 en amont, se blesse assez sérieusement
à la cuisse en désescaladant des lames de roche. Le plus dur
sera de le rejoindre, malgré ses appels, dans le fouillis de petites
galeries et de blocs du secteur (Dorey Monique et M., Degouve P. et S., Simonnot).
14 juillet 1983 : tentative de désobstruction dans
les trémies en amont de la rivière du puits Buffard (Degouve
P. et S., Simonnot)
Le 28 juillet 1983, l’entrée de la sima Tonio
est indiquée aux membres du SGCAF par un berger, Manuel Antonio Peral
Abascal. Après des travaux de désobstruction une première
branche est explorée jusqu’à –210 (Emonts-Pohl,
Lismonde, Morverand, Schulz).
Le 28 décembre 1983 l’exploration bute à
–228.
1984
Un an plus tard le 28 décembre 1984
une grosse désobstruction a lieu dans la trémie de la galerie
Tantale à la Cayuela mais sans résultat majeur (SGCAF).
1987
L’exploration de la sima Tonio reprend au niveau d’une
galerie repérée par J.L. Galera en 1983. A partir du 2
août des travaux sont entrepris en commun par le SGCAF et le
SC Paris pour aboutir à la jonction avec la salle Guillaume de la Cayuela
le 14 août (Dedieu, Lismonde).
1995
Un petit réseau ventilé sans suite est parcouru
(dans le secteur de la galerie Est ?) (SG Hauts-de-Seine)
1997
Découverte, au départ de la galerie Est, du méandre
Gloria (environ 300 m, SGHS)
1998
Le même club poursuit ses investigations dans le réseau
Gloria (partie centrale)
1999
Les explorateurs connectent le réseau Gloria avec l’accès
à la galerie des Scies. Dans la foulée le méandre de
la Souris est découvert (SGHS). L’ensemble des galeries parcourues
dans le réseau Gloria développe 3 km. Développement :
12585 m.
Entre août 99 et février 2000
le SGCAF reprend la désobstruction de la trémie de la galerie
Tantale. L’obstacle s’avère toujours intraitable.
2000
L’amont de la galerie Vespasien est poursuivi (au-delà
d’un terminus qui attendait toujours les explorateurs depuis plus de
trente ans) sur plus de 600 m (SG Hauts-de-Seine)
Développement : 13200 m.
2010
26 juillet : Le siphon aval de la rivière
du Labyrinthe (collecteur) est plongé dans l’espoir de rejoindre
l’amont de la Cubiobramante exploré l’année précédente.
Environ 300 m de galeries sont ajoutées mais la liaison ne peut être
établie. (plongeur Manu Tessane)
Développement : 13500 m.

Manu Tessanne au départ du siphon aval
de la rivière du Labyrinthe. L'objectif était de tenter la jonction
avec la résurgence (Cubiobramante).
 < Télécharger la coupe détaillée de la Sima
Tonio (n°830)- Format A4 PDF (188 ko)
< Télécharger la coupe détaillée de la Sima
Tonio (n°830)- Format A4 PDF (188 ko)
Accueil Karstexplo
| Karst des Alpes
| Cuevas del Alto Asón